Liquidation du quotidien historique de Tahiti, avenir incertain pour les salariés du Quotidien de l’île de la Réunion, perte massive d’emplois aux Nouvelles Calédoniennes, pis-aller pour France-Guyane, naufrage évité de peu en Martinique et en Guadeloupe. La presse écrite et quotidienne va mal dans les territoires ultramarins. Et la pandémie n’arrange rien.
La vie économique des médias n’a jamais été tranquille et leur histoire s’écrit au gré des changements de direction et d’actionnaires. Cependant, la situation des quotidiens d’information dans les différents territoires d’Outremer est sérieusement chahutée à l’image de l’ensemble des journaux français et à l’international. Le cycle en cours n’est pas rassurant. « Les changements de main, il y en a toujours eu dans la presse écrite, mais il s’agissait de changement d’actionnaires de journaux qui fonctionnaient bien avec une volonté pour les actionnaires d’investir. Aujourd’hui en revanche, on note que la volonté des repreneurs, c’est surtout de sauver le peu qui reste en supprimant des effectifs et en renonçant à certains moyens. Souvent au bout de deux ans, l’actionnaire se rend compte qu’il ne peut rien sauver, et là potentiellement on rentre dans un cycle où tous les deux-trois ans on va changer d’actionnaires », note Pierre-Yves Carlier, ancien rédacteur en chef adjoint de France-Guyane. Depuis 1976, année de la création de ce journal modeste, le quotidien guyanais fut englobé dans l’empire de presse de Robert Hersant, passant du patriarche, à son fils puis à sa petite-fille. Le 30 janvier 2020, le journal publiait sa dernière « une » après le prononcé de la liquidation judiciaire du groupe France-Antilles, scellant la disparition dans cette collectivité de 300 000 habitants d’une édition papier journalière. En six ans, la chute fut inexorable pour ce seul quotidien de Guyane qui parvenait à sortir 4 400 exemplaires par jour en 2011, sa plus belle année.
Les deux autres quotidiens du groupe France-Antilles, édités en Martinique et en Guadeloupe, auraient connu la même dislocation si Xavier Niel, co-actionnaire du Monde n’avait proposé une offre de reprise, celle-ci fortement épaulée par l’État pour « 3,5 millions d’euros ». Soutien considéré par Olivier Pulvar, maître de conférences à l’université des Antilles comme la confirmation « d’une continuité dans la gestion par l’État des affaires outre-mer ». Cette reprise s’est néanmoins accompagnée de restrictions notables : la baisse de 50 % des effectifs, la fermeture de l’imprimerie en Martinique pour une mutualisation des tirages depuis la Guadeloupe, l’arrêt du numéro du week-end et une pagination réduite la semaine.
En mai 2020, face aux difficultés en cascade ressenties aux Antilles comme dans l’océan Pacifique et à La Réunion, les ministres de la Culture et des Outre-mer lancèrent une « mission sur l’état de la presse ». Aujourd’hui, les aides nationales se matérialisent principalement par des allègements fiscaux ou sur les contributions sociales, un système que les patrons de presse des territoires voudraient voir évoluer puisqu’ils pointent la prédominance de problèmes de « trésorerie ».
Le 15 juillet 2020, lors de leur audition par la délégation outre-mer à l’Assemblée nationale, les dirigeants se montrèrent graves face à l’ampleur encore incertaine de l’impact du coronavirus sur le secteur. Ils rappelaient d’ores et déjà la discrimination dont ils souffrent, puisque les aides publiques allouées Outremer sont injustement minorées de celles attribuées aux journaux de France. Elles excluraient aussi de manière croissante les territoires partiellement autoadministrés que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Mi-2020, Paris envisageait « la création d’une aide pérenne pour les titres ultramarins dont le versement devrait être effectif en 2021 ». Ce qui signe le maintien discriminatoire du traitement différencié de la presse écrite ultramarine. À l’issue de la « première vague », le ministère de la Culture s’était engagé à débloquer « une aide exceptionnelle pour faire face au Covid-19 ». Cette aide était annoncée pour la fin d’année 2020.
Le Journal de l’île de la Réunion (le JIR, qui tire à « 16 000 » exemplaires par jour) aurait par exemple « perdu 800 000 € de recettes publicitaires » à cause de la pandémie, selon la femme politique Audrey de Fondaumière et aussi membre de la direction du JIR.
L’iniquité de l’accès aux fonds publics n’explique évidemment pas à elle seule le naufrage des journaux. Il y a quelques semaines, en Polynésie, le quotidien historique, La dépêche de Tahiti, a lui aussi fini par s’écrouler. Dominique Auroy, l’homme d’affaires sulfureux de Rangiroa avait mis la main en 2014 sur les deux quotidiens : La Dépêche et Les Nouvelles, journal reconnu pour la qualité de son contenu, mais qui avait très vite été liquidé. Restait la Dépêche, qui vivotait, amputée de « ses meilleurs journalistes » de l’avis d’un confrère polynésien. Sans grande surprise, le journal a fini par se « casser la figure », laissant le champ libre au nouveau titre montant Tahiti infos. Détenu par Fenua communication, aussi propriétaire d’un magazine télé, de l’hebdomadaire Tahiti Pacifique et des Nouvelles de Tahiti, Tahiti infos semble à première vue le seul contre-exemple du déclin des quotidiens ultramarins.
Des erreurs de gestion, des condamnations aux Prud’hommes, un contenu appauvri expliquent en partie les difficultés ressenties ici ou là et s’ajoutent aux atteintes portées par le recul des ventes et la perte des revenus publicitaires.
À la Réunion, le JIR (placé en sauvegarde) et Le Quotidien de l’île de la Réunion et de l’Océan indien sont actuellement en mauvaise posture financière. « Les décennies 1980-1990 ont été celles de l’essor, pour ces deux titres. Mais l’érosion des ventes papier, même si le tournant numérique a été amorcé depuis longtemps, du moins pour le JIR (avec Clicanoo, qui fut le premier journal d’outremer à s’être lancé dans le numérique dès 1996), n’a pas été encore contrebalancée par un modèle économique véritablement rentable », note Bernard Idelson, professeur en sciences de l’information et de la communication (SIC) à l’université de La Réunion. Même constat à Tahiti. Pour Mike Leyral, journaliste et intervenant à l’institut supérieur de l’enseignement privé de Papeete : « L’évolution est absolument phénoménale : si tout le monde regardait le JT il y a 20 ans, aujourd’hui mes étudiants me disent qu’ils ne le regardent plus du tout et qu’ils ne lisent quasiment plus les journaux papier ».
« Aujourd’hui non seulement on a des concurrents sur des supports différents, mais notre premier combat c’est d’abord de convaincre les gens que ça vaut le coup de payer pour une info », pointe l’ancien rédacteur en chef adjoint de France-Guyane. « Nos principaux concurrents ce sont la machine à café, la sortie d’école et le repas de famille du dimanche. Si à ces trois endroits on a l’impression d’en apprendre plus qu’en ouvrant le journal le matin alors pourquoi mettre 1 € dans un journal ? » questionne l’ancien rédacteur en chef adjoint de France-Guyane.
Au Quotidien ( 22 000 exemplaires par jour, sous redressement judiciaire) « une restructuration organisationnelle est inévitable et s’accompagnera vraisemblablement de mesures sociales » , sait Edouard Marchal, journaliste de la rédaction. « Le journal a subi de plein fouet l’impact du Covid ainsi qu’une condamnation à verser 540 000 € à son ancien directeur général. Ces deux événements se sont ajoutés à une crise structurelle », poursuit-il. L’instabilité financière des dernières années a ainsi engendré une montée des tensions en 2019. « Quelques mois après son arrivée, le directeur en chef a décidé de ne pas publier deux articles qui concernaient les projets du groupe Hayot, un important annonceur à La Réunion. Il a justifié sa position par la défense des intérêts financiers du journal dans “un temps économique préoccupant « » sonne gravement le journaliste.
En Calédonie, le rachat en 2013 des Nouvelles Calédoniennes, ( 10 000-12 000 exemplaires jour ) par trois magnats de l’automobile, du nickel et de la grande distribution (Groupe Melchior) avait entraîné une mobilisation des journalistes qui y voyaient une « potentielle “mainmise” sur l’expression journalistique dans les pages du seul quotidien de Nouvelle-Calédonie » relatait alors Calédonie 1e. Après une semaine de négociations, les journalistes annoncèrent avoir obtenu « des garanties minimales » leur permettant de travailler « en toute indépendance ».
Derrière le phénomène d’oligopole médiatique, qui fut scellé Outremer par l’empire Hersant il y a cinquante ans et demeure flagrant à travers notamment du réseau France Télévisionss, se pose la question de la pluralité de l’information. La disparition évitée de France-Antilles aurait dû dépasser le simple émoi collectif et questionner en profondeur la « pluralité de l’information », de laquelle se prévalent les patrons de presse ultramarins.
Pour l’universitaire Olivier Pulvar, « depuis 1964, il n’y a qu’un seul support de presse en Martinique et en Guadeloupe. Il aurait fallu s’alarmer de cela depuis longtemps. Le seul qui a essayé de créer une concurrence n’a pas été soutenu. En Martinique nous sommes entourés par deux îles indépendantes [la Dominique et Sainte-Lucie, NDLR] qui ont plusieurs journaux. Plutôt que de faire évoluer le système , on maintient le statu quo [par le soutien apporté par l’État à la reprise de France-Antilles par Xavier Niel, NDLR]. Et ça, c’est une des caractéristiques sur nos territoires : la gestion de la chose publique pour un maintien du statu quo et de la paix sociale, pour que si les choses bougent, elles bougent le moins dans le sens qui dessert les intérêts de la République ».
« Je ne suis pas pour des journaux qui vivraient sous perfusion et subventions » , commentait Laurent Canavate de Flash infos Mayotte lors de son audition par des députés en juillet dernier. Pour ce directeur de publication, « si on veut redonner à la presse toute sa force et sa vigueur, il faut qu’elle reprenne son rôle de transmission du lien social » tout en se diversifiant vers « l’édition et l’événementiel ». « Si on reste sur l’idée de vendre du papier, on est mal barré, et si on pense que l’on va compenser la publicité perdue par du numérique, les abonnements ou la publicité par le numérique, c’est limité », conclut le directeur.
Texte de Marion Briswalter




 Français
Français English
English  Português
Português 










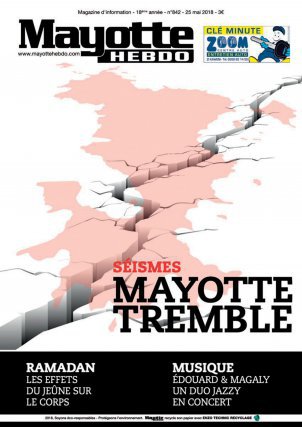


 Pas de réaction
Pas de réaction Commentaire fermé
Commentaire fermé


 Rendez vous Club de la presse : Liberté de la presse et droit des journalistes
Rendez vous Club de la presse : Liberté de la presse et droit des journalistes
 Conférence à l’EnCRe : regard sur la presse en Guyane de 1900 à 1967
Conférence à l’EnCRe : regard sur la presse en Guyane de 1900 à 1967
 Union de la Presse Francophone de Guyane : naissance d’une association de journalistes pour la francophonie
Union de la Presse Francophone de Guyane : naissance d’une association de journalistes pour la francophonie



